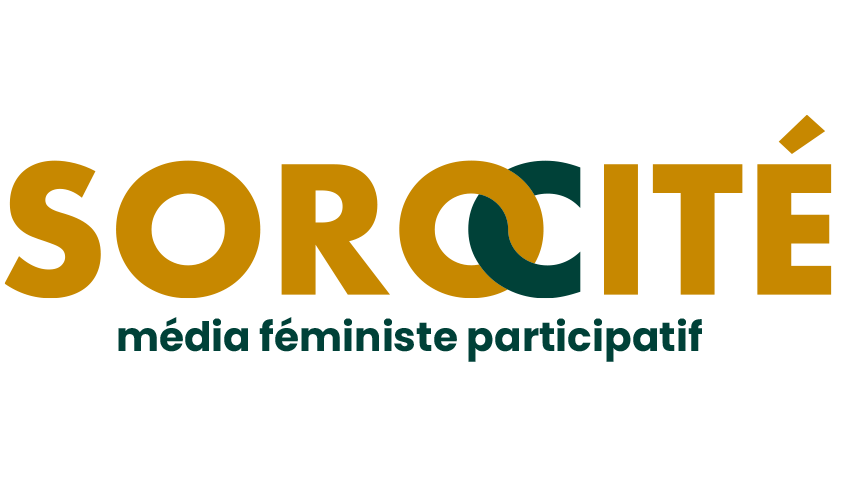par Cécile Spanu
L’écoféminisme s’invite de plus en plus sur la scène militante et médiatique française. Un courant pourtant pensé, conceptualisé, mis en pratique et vécu dès les années 1970. Mais l’écoféminisme d’hier est-il le même que l’on arbore aujourd’hui ? Zoom sur les luttes actuelles et les militant·e·s qui les incarnent.
Un week-end en mixité choisie (sans hommes cis) rassemblant des militant·e·s anti-nucléaires. Une marche festive et colorée de 500 personnes, femmes, trans, queer et non-binaires défilant joyeusement, en scandant leurs slogans anticapitalistes le long du territoire d’une puissante entreprise du nucléaire : l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA).
Nous sommes en 2019. Ce rassemblement est organisé par le collectif des Bombes Atomiques en 2019, près de Bure dans la Meuse, où des militant·e·s se battent contre le projet d’enfouissement de déchets radioactifs Cigéo depuis quelques années. Le combat (toujours en cours) mené par les membres du collectif remet au goût du jour les luttes féministes et anti-nucléaires nées dans les années 1970 et 1980, qualifiées pour la première fois “d’écoféministes”.
“Écoféminisme”. Un terme à la “mode”, bien qu’on ne sache pas toujours ce qui se cache derrière. Plus qu’une simple apposition des mots “écologie” et “féminisme”, l’écoféminisme désigne une multitude de mouvements, de pensées et d’actions militantes, réunis par une conception commune : celle que l’oppression des femmes et l’exploitation de la nature (ou du “non-humain”) ont une même origine : le système patriarcal et capitaliste. Plus largement, les écoféministes cherchent à abolir toutes les formes d’oppression et de domination (sexisme, racisme, colonialisme, homophobie, transphobie, validisme, spécisme, classisme) liées à un même système.
C’est notamment la démarche du collectif écoféministe français “Voix Déterres” : “Nous pensons les luttes écologiques et féministes de façon indissociables et attaquons de front un patriarcat blanc, hétéronormatif, capitaliste et écocidaire. Notre perspective est révolutionnaire, transespèce, queer et magique“, peut-on lire sur le site internet.
Quarante ans d’absence
Le mot écoféminisme aurait fait son apparition pour la première fois en 1974 sous la plume de l’écrivaine et militante française Françoise d’Eaubonne, dans son ouvrage Le féminisme et la mort. L’autrice y fait le lien entre l’oppression patriarcale des femmes et l’exploitation capitaliste de la nature. Mais le terme ne “prend pas“ au sein des groupes militants français, qu’ils soient écolo ou féministes. Les héritières de Simone de Beauvoir y voient notamment pointer l’ombre de l’essentialisme – soit l’idée que les femmes seraient “par essence” plus proches de la nature que les hommes – et pour lesquelles le concept de nature est l’une des causes de l’oppression des femmes.
Pourtant – comme l’explique la philosophe française Émilie Hache dans un article de Reporterre – les écoféministes revendiquent au contraire une autre vision des choses. Elles rejettent (tout autant que les féministes matérialistes) l’enfermement des femmes dans certains rôles sociaux et il n’est pas question pour elles d’un « retour en arrière ». Mais, depuis très longtemps, la culture misogyne patriarcale a dévalorisé tout ce qu’on attribue aux femmes : le soin, le corps féminin, les émotions, la féminité… ainsi que tout ce qui touche à la nature (par opposition à la culture). Les écoféministes ont alors choisi de revendiquer, se réapproprier (reclaim) et revaloriser ces concepts. Elles montrent ainsi que la séparation de la nature et de la culture est la marque d’un système capitaliste extractiviste, qui a conduit à l’exploitation des ressources naturelles et à la disparition de la biodiversité. Elles remettent également en cause les visions dualistes de nos sociétés modernes qui induisent une hiérarchisation, telles les oppositions corps/esprit, raison/émotions, homme/femme, humains/animaux. Leur conception renvoie aussi à « une complémentarité entre toutes les formes de vie sur la Terre qui permettrait de “construire un monde débarrassé de toute forme d’oppression”, explique la sociologue Anna Berrard dans l’article “L’écoféminisme aux abois : Marchandisation, manipulation et récupération d’un mouvement radical”, paru en janvier 2021 dans la revue Le Crieur.
En France, après d’Eaubonne, le terme ne réapparaît plus dans le paysage militant et intellectuel, et c’est ailleurs à l’international que le mouvement va germer, puis se développer (notamment aux États-Unis et en Angleterre).
Aujourd’hui, l’écoféminisme semble revenir en force dans notre pays. Il s’est même invité dans la primaire écologiste en septembre dernier, à travers la candidate revendiquée “écoféministe“ Sandrine Rousseau, du parti Europe Ecologie les Verts . Mais l’apparition de l’écoféminisme sur la scène médiatique “mainstream“ s’accompagne souvent de définitions confuses, voire de contre-sens. Là encore, on retrouve l’apposition des termes « écologie » et « féminisme », tandis que des accusations d’essentialisme voire d’”irrationalisme” ressurgissent. Sandrine Rousseau, elle, fait bien le lien entre domination patriarcale et destruction de la nature. Elle revendique également sa “radicalité“. Or, si ses propos opèrent bien une rupture vis-à-vis du discours dominant de la scène politique et médiatique, la candidate à la Présidentielle s’inscrit dans une institutionnalisation et donc une validation du système étatique. Ce que rejettent de nombreuses militantes écoféministes, qui prônent plutôt des valeurs comme l’autogestion et l’auto-détermination, proches de la pensée anarchiste.
Principalement incarnées par des collectifs et des associations, les luttes écoféministes actionnent différents leviers et donnent au mouvement des visages multiples. Alors que certain·e·s militant·e·s amorcent le dialogue par le biais des médias ou de la scène politique, d’autres préfèrent combattre sur le terrain. Elles investissent des ZAD et refusent la prise de parole publique pour privilégier les actions directes, à l’instar des Bombes Atomiques, à Bure. D’autres encore choisiront une troisième voix, comme lutter pour les valeurs en lesquelles elles croient, sans revendiquer l’étiquette écoféministe, de peur d’un amalgame avec des idées encore trop peu comprises par la société française, à l’instar du collectif Rosae Canine. Aujourd’hui, les écoféministes réhabilitent des valeurs et notions comme les émotions, l’autonomie, l’horizontalité et la non-hiérarchisation.
Réhabilitation et réappropriation
L’art occupe également une place à part entière dans l’écoféminisme. Chez Gang of Witches, collectif artistique écoféministe, il est même un pilier. Sabrine Kasbaoui, journaliste, réalisatrice et animatrice du podcast du Gang, nous explique : “Nous vivons dans une société qui a porté aux nues l’intellect et l’esprit analytique. Il s’agit donc de nous reconnecter à nos émotions. Or l’étymologie d’émotion, c’est ‘mettre en mouvement’, c’est-à-dire faire ‘sentir penser’ à travers la création : on a besoin de nos sensations et émotions, c’est ce qui nous met en mouvement”.
Le collectif Rosae Canine créé en 2018, lui, s’adresse aux “amoureuses des plantes et des luttes séditieuses”. S’il ne se revendique pas explicitement écoféministe, le groupe expose des valeurs qui y correspondent : “C’est une révolte joyeuse, à genoux dans l’herbe haute, un récit de voyages initiés, le journal intime de nos recherches, une expérience sensible de partage autour des corps. Notre soulèvement est politique, anticapitaliste, libertaire et nous contestons toute forme d’oppression”.
Axées autour du partage et de la découverte des savoirs ancestraux sur les plantes, les activités proposées par le collectif sont pensées comme une manière de “se réapproprier l’espace public”. Ce sont aussi des moments où l’on va parler féminisme, remettre en cause l’hétéronormativité et la binarité des genres, à travers notamment l’apprentissage du monde botanique. “Dans l’histoire des plantes, on peut parfois lire qu’il y a que des plantes ‘mâles’ et que des plantes ‘femelles’. Nous, on a envie de poser un autre regard là-dessus. On considère par exemple qu’il est important de rappeler que certaines d’entre elles sont hermaphrodites, car cela permet de démonter les théories naturalistes et de mettre en relation le monde des plantes avec le féminisme et les théories queer”, nous explique une membre du collectif.
La valorisation de ces savoirs se retrouve chez les écoféministes revendiquant une forme de “sorcellerie”. La Sorcière est d’ailleurs une figure qui a fortement réémergé ces dernières années au sein des cercles féministes, notamment depuis la parution en 2018 de l’essai Sorcières : la puissance invaincue des femmes,de Mona Chollet ; et à travers les rééditions des ouvrages (aux éditions Cambourakis) de l’Américaine Starhawk, autrice et militante écoféministe, qui se décrit elle-même comme “néopaïenne” et “sorcière”. La sorcière symbolise une femme libre, souvent guérisseuse, proche de la nature, puissante et autonome. “Ce qui est intéressant avec cette figure de la sorcière, c’est de voir comment les féministes des années 1960 et 1970 se sont emparées de cet archétype pour en faire une figure puissante et féministe qui évolue à la marge et entre différents milieux. Elle permet d’invoquer à la fois un désir de reprendre en main son destin et une forme de radicalité dans le militantisme féministe écologique et antiraciste”, estime Sabrine Kasbaoui, du collectif Gang of Witches.
“Écofemwashing” Vs lutte radicale
Depuis leur naissance, les luttes écoféministes se caractérisent par leur radicalité. Aujourd’hui, le mouvement s’illustre à travers des combats plus contemporains (décoloniaux, queers, antispécistes), suivant les évolutions des mouvements féministes et écologistes radicaux. Pourtant, il n’échappe pas aux “récupérations” marketing et capitalistes de nos sociétés modernes, tout comme il existe du “greenwashing” et du “femwashing”.
“Alors que l’écoféminisme commence à peine à se libérer des accusations d’essentialisme et d’apolitisme qui conduisirent à son déclin dans les années 1990, son appropriation opportuniste par les chantres du marketing et les nébuleuses fascisantes ne peut que faire craindre un nouvel ostracisme, rendant plus que jamais nécessaire la revendication d’une lutte radicale”, explique très justement la chercheuse Anna Berrard.
L’écoféminisme est, en effet, encore trop souvent, soit utilisé comme raccourci (par exemple pour désigner des féministes “adeptes du zéro déchet”), soit amalgamé avec un essentialisme “de féminin sacré“ et flirtant avec le développement personnel tendance et “instagramable“. Il devient ainsi nécessaire de se souvenir de ces luttes radicales et anticapitalistes, de rappeler leurs origines, afin d’éviter tout procédé de dépolitisation des discours et de pouvoir construire nos propres récits écoféministes contemporains.